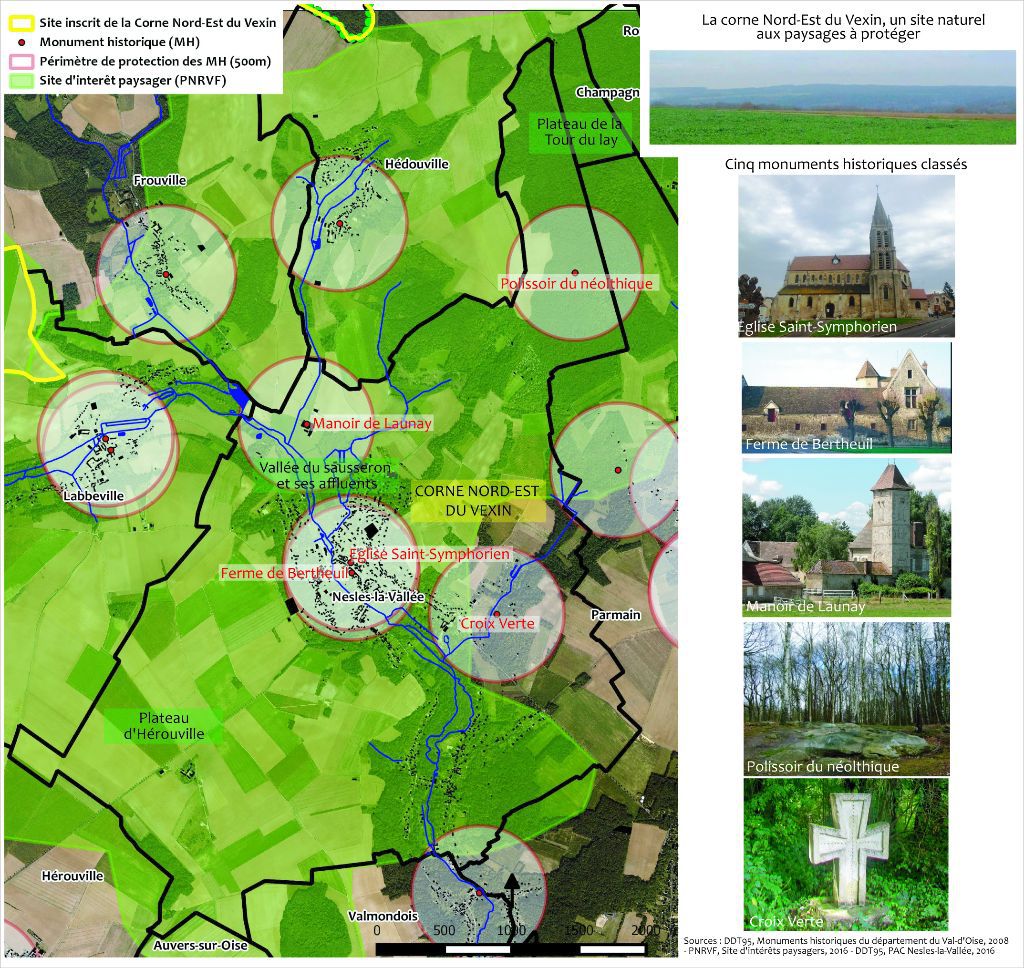Le PADD est l’un des éléments essentiels du Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est un outil de définition des orientations politiques et actions prévues de la commune en matière d’aménagement de son territoire. Le PLU fixe aussi les règles et servitudes d’utilisation des sols. En l’espèce, le PADD fixe les grandes orientations d’utilisation des sols et de leur aménagement à l’horizon 2035. C’est donc un élément structurant de l’urbanisme du village.
En termes de nouveaux logements à créer ou aménager d’ici cette date, l’objectif cité dans le PADD évoque une fourchette de 95 à 137 nouveaux logements.
La concertation, pour accompagner un projet collectif et structurant
Une concertation avec la population est requise pour toute élaboration de PLU (ou de sa révision). Cette concertation est réalisée sous la direction de la municipalité à destination des habitants, des associations locales et des différentes parties concernées dont les représentants de la profession agricole.
La loi n’impose aucune forme particulière de modalités de concertation. Celles-ci sont décidées librement par la municipalité lors de la prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. Cependant, une fois celles-ci fixées, celles-ci doivent être mises en œuvre et respectées.
Il s’agit bien d’une concertation et non d’une consultation, ce qui implique 1) une information suffisante et régulière ; 2) la possibilité pour la population de faire des propositions ; 3) la possibilité d’ajouter des suggestions ou des observations à tout moment ; 4) une continuité de la concertation tout au long des études et de la prescription, ceci jusqu’au projet arrêté par la commune.
La concertation s’arrête au moment de l’arrêt du projet de PLU. La délibération doit dresser un bilan de cette concertation, et mentionner les propositions retenues ou comment elles ont influencé le projet. Un débat doit être organisé au sein du conseil municipal au mois 2 mois avant l’arrêt du projet. L’information du Préfet est effectuée en continu tout au long de la procédure. les groupes de travail ne sont plus figés et peuvent se constituer à la demande des personnes publiques intéressées ou de la commune. L’obligation de passer par une enquête publique pour tout changement ou modification du PLU, sauf cas exceptionnels prévus par la loi.
Le PADD, un projet d’aménagement clairement affiché par la commune
- le PADD est une pièce à part entière du dossier ;
- il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la municipalité pour l’ensemble de la commune ;
- il n’est pas possible de modifier le PLU entre le projet arrêté et l’enquête publique, d’où nécessité d’avoir un projet très clair et une association efficace avec les personnes publiques.
Les zones du PLU sont les suivantes :
- les zones A agricoles, équipées ou non, où les constructions admises sont très limitées (agricole et services publics),
- les zones AU à urbaniser, urbanisables en fonction de la réalisation des réseaux ou d’une opération d’ensemble, ou de réserve foncière si les réseaux sont insuffisants. Les orientations d’aménagement définissent les conditions d’aménagement de ces zones,
- les zones N naturelles de protection, équipées ou non équipées,
- les zones U urbaines ou équipées.
Voici le dernier document dont nous disposons, préparé par le cabinet Altereo à l’intention de la commune pour la réunion de travail du 22 mai, avant la réunion d’information proposée par la mairie le 27 mai, et dont l’affichage public – qu’on peut qualifier de discret – n’a pas attiré de nombreux Neslois… C’est un document de travail, donc par définition, non définitif, mais les grandes orientations qui y sont rapportées ne peuvent pas être très différentes, sauf à refaire un cycle de travail, ce qui n’est sans doute pas la volonté de la commune. Nous le publions ici sous toutes réserves de mise à jour qui auraient été faites depuis la réunion sus-mentionnée et pour la réunion d’information publique à laquelle nous n’avons pas assisté, faute d’une information suffisante.
À lire vos commentaires, si vous le souhaitez.